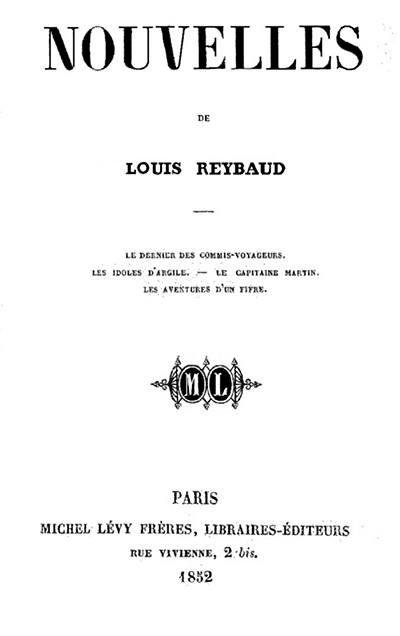
LE CAPITAINE MARTIN
OU
LES TROIS CROISIÈRES.
I
Le cadeau de noce.
Parmi les ports français qui se rendirent, vers la fin du dix-septièmesiècle, redoutables dans la guerre des corsaires, il faut placer enpremière ligne Saint-Malo. C'est de là que partaient pour la course lesbâtiments les plus légers, les équipages les plus intrépides. La Manchesemblait, appartenir à ces hardis enfants de la mer, et les richesconvois qui revenaient des deux Indes ne traversaient pas impunément cesparages. Dans le cours d'une seule année plus de cent prises entrèrentdans ce petit port. L'or ruisselait, pour ainsi dire, dans la ville; lesmarchandises les plus précieuses y étaient vendues à vil prix. De grandsdommages furent ainsi causés au commerce anglais; et la chose en vint aupoint, que l'amirauté crut devoir envoyer, en 1693, une flotte de vingtvaisseaux, armés de machines infernales pour incendier l'asile de nosinfatigables croiseurs. Contenue par les batteries de la côte,l'expédition échoua, et Saint-Malo ne s'en montra que plus animée contrel'Angleterre. La fortune servit si bien les entreprises de ses marins,que la ville put offrir, en 1710, trente millions de francs à Louis XIV,dont le trésor était épuisé par de longues et ruineuses guerres.
Cette période fut donc à la fois glorieuse et fructueuse pour les bravesMalouins. Elle tient une grande place dans leur histoire. Voici unépisode qui s'y rattache:
Dans les derniers mois de l'année 1690, deux Hommes marchaient avecvivacité sur la jetée qui unit l'île de Saint-Malo au continent; tousles deux étaient fort jeunes, quoique leur figure, hâlée par le soleilet l'air de la mer, eût déjà un caractère de virilité. On leur eut donnévingt-cinq ans; ils n'en avaient pas vingt. Malgré la familiaritéapparente qui régnait entre eux, il était facile de voir, à ladifférence des costumes, qu'ils n'appartenaient pas à la même classe.L'un était vêtu avec une élégance qui le rattachait évidemment à labonne bourgeoisie, au commerce opulent de la ville. Ses manchettes, sonjabot, son chapeau relevé d'un galon, son pourpoint de velours, sessouliers à boucles d'or, tout contribuait à faire valoir sa bonne mine,son air mâle et décidé, son port avantageux. L'audace, la résolutionrespiraient dans ses traits, dans son front élevé, dans ses yeux bleus.Il y avait en lui du héros et de l'aventurier; ses ennemis devaient lecraindre, les femmes devaient l'aimer. L'autre n'avait rien de cesdehors séduisants; mais sa figure exprimait une certaine jovialitépleine de finesse. Ramassé et trapu, il paraissait doué de cette agilitémusculaire qui distingue les races du littoral breton. Son teint étaithaut en couleur; ses cheveux blonds se nuançaient jusqu'au roux. Cetensemble assez peu flatteur n'était pas sauvé par le costume; quiconsistait en un paletot et des braies en grosse ratine brune, un bonnetde laine et des bottes évasées comme en portaient alors les pêcheurs dela côte.
Au moment où les deux interlocuteurs abordèrent le quai, la conversationétait vivement engagée entre eux:
--Toi, Martin, tourner à la tristesse! Je ne te reconnais pas là, mongarçon.
--Monsieur Duguay, c'est pourtant comme ça! Si le vent souffle toujoursdu même bord, je suis un homme perdu.
--Il n'y a donc plus de genièvre dans les cabarets de Saint-Malo?
--Quand le cœur est plein, monsieur Duguay, il n'y a point de placepour le reste. Le genièvre et moi nous ne courons plus la même route.
--Diable! tu es bien malade, alors. Conte-moi ça.
--Vous connaissez la fille